Comme un lent et sûr changement dans nos vies d’européen : l’Europe se teinte d’américanité, dans une hégémonie de plus en plus assumée. Telle est la thèse du philosophe Régis Debray dans son dernier essai, « Civilisation », qui vient de paraître chez Gallimard. Par RAPHAËL GEORGY
Notre Europe s’américanise. Le Nouveau monde rattrape le Vieux continent. Pour le montrer, Régis Debray part non d’Europe ni d’Amérique, mais de l’autre bout du monde dans la plus ancienne civilisation encore en vie : la Chine. Celle-ci a l’avantage de porter de l’attention aux transformations imperceptibles et silencieuses quand nous autres européens survalorisons l’événement, le basculement spectaculaire.
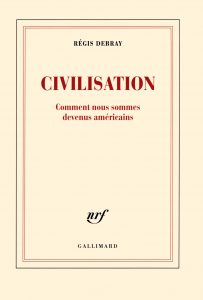 Le philosophe, tout au long des 231 pages d’un essai qui se lit comme un roman, choisit l’approche chinoise et met en perspective une série de changements en pointillés pour former une large fresque de notre civilisation sur la pente douce. Celle du déclin.
Le philosophe, tout au long des 231 pages d’un essai qui se lit comme un roman, choisit l’approche chinoise et met en perspective une série de changements en pointillés pour former une large fresque de notre civilisation sur la pente douce. Celle du déclin.
Car pour qu’une civilisation prenne le pas sur la nôtre, il faut que la première se rende désirable. Il y a d’abord, en la matière, les tournants décisifs et perceptibles par chacun. On l’oublie parfois, la France a déjà été sauvée du pire par les États-Unis d’Amérique à deux reprises, en 1917 et en 1944. Si cela ne crée pas en soi une dette et une admiration éternelles…
« Si elle ne transfigurait pas son histoire en légende avec de beaux mensonges et des héros fondateurs controuvés, improbables ou farfelus – la déesse japonaise Amaterasu, Enée ou Vercingétorix –, une civilisation ne ferait pas un foyer d’appartenance, mais une académie des sciences. » (p. 16)
Tout l’enjeu des civilisations réside dans le consentement à la domination. Toutes ont eu recours aux armes pour s’imposer. Une fois que l’empreinte est marquée, il n’y a plus qu’à se retirer pour continuer à exercer une influence souterraine : les « colonisés » sont convaincus que cette influence leur est bénéfique. C’est ce qu’ont réussi à faire les États-Unis.
Régis Debray cite un édifiant sondage IFOP dans la France de 1945 avec cette question : « Quelle est selon vous la nation qui a le plus contribué à la défaite de l’Allemagne ? ». « Les Français répondaient l’URSS pour 55 % et les Etats-Unis pour 15 %. Le même sondage en 2004, donne un résultat exactement inverse », relate-t-il. Curieux retournement.
De l’empire à l’emprise
Car « qui aime imite ». Ainsi des foules entières désirent aujourd’hui le dernier iPhone, prêtes à dépenser des sommes ahurissantes dans la dernière invention high-tech à la mode. Facebook et Google sont parvenus à nous persuader qu’ils étaient les meilleurs dans leur domaine, justifiant leur monopole écrasant. Sans compter un progrès technique que l’on serait bien bête de renier : réfrigérateur, grille-pain, aspirateur, micro-ondes, gaufrier électrique, etc.
À ce stade, l’auteur met sa casquette de « médiologue », la discipline qu’il a lui-même créée et qui s’attache à étudier la transmission des idées dans l’histoire longue. Et il tranche :
« L’Amérique est entrée dans l’histoire et dans nos cœurs par l’image ; elle a la fibre optique. L’Europe dans l’histoire et nos cerveaux par des écrits ; elle a la fibre logique. » (p. 117)
La force de l’influence américaine tient donc à la puissance de l’image. En plus de cela, les États-Unis conservent dans leurs textes, sinon dans l’âme de leur nation, une transcendance, un mythe fondateur sacré ou religieux qui leur confère une assurance mobilisatrice.
« La mission des États-Unis, assurer le bonheur de l’humanité, leur est confiée par Dieu. Celle de Rome, par Jupiter » (p. 185)
Et de citer le président américain Woodrow Wilson qui déclarait en 1917 :
« Les principes américains sont les principes de l’humanité et ils doivent l’emporter. »
Amour-propre
La domination assumée se transforme en hégémonie lorsqu’elle est souhaitée et vécue comme une promotion par le dominé.
« Pour de Gaulle, la mise en temps de paix des forces françaises sous un commandement étranger, dit intégré, était une blessure d’amour-propre. Pour MM. Sarkozy et Hollande, ce fut un motif de fierté. » (p. 202)
Une civilisation est au contraire conquérante lorsque des idées étrangères se heurtent à elle comme sur un mur.
« Elles ont des douanes invisibles, note Braudel, et un filtrage sans filtre. La bulle d’excommunication ou l’arrêté de reconduite ne sont nullement indispensables, tant l’allergie opère spontannément. […] Le Perse chiite a fait barrage aux incursions sunnites, arabes ou ottomanes. La greffe marxiste a été rejetée par le monde anglo-saxon, hors quelques enclos académiques. » (p. 14)
Aujourd’hui, l’homo œconomicus a débarqué en Europe. « De Gaulle, évoquant Jeanne d’Arc, parlait de l’’honneur d’être pauvre' », rappelle Debray, quand Nicolas Sarkozy avait lancé qu’après son mandat, il « [changerait] de vie » et « [ferait] de l’argent ».
Depuis 1919, le français n’est plus la langue de la diplomatie après que le président Wilson a exigé une version en anglais du traité de Versailles. En 1974, Valéry Giscard d’Estaing fait sa première allocution de président élu en anglais. Alors que de Gaulle, s’il parlait dans la langue du pays d’accueil lors de ses voyages officiels, s’exprimait en France dans la langue de Hugo.
Aujourd’hui, on ne compte plus les anglicismes qui déferlent dans notre vocabulaire courant. On dit « maintenance » au lieu d' »entretien », « au final » (in the end) pour « en fin de compte », « manager » pour « directeur », « digital » pour « numérique », « paver la voie à » (to pave the way to) pour « ouvrir la voie à », « packaging » pour « emballage », « impacter » (to impact) pour « toucher », « sponsor » à la place de « mécène », ou encore « parade » en lieu et place de « défilé ». Sans compter les -isme prononcés « izeum » à l’américaine… Le changement est si bien rentré dans les habitudes que ce sont ceux qui parlent simplement la langue française qui apparaissent aujourd’hui comme des anormaux…
Tout ce qui nous reste en propre est ce qui est « d’autant mieux respectés à l’international que non alignés sur l’international : la gastronomie et la galanterie, qui avaient la langue de Molière comme ornement et faire-valoir. » (p. 65)
Passer gaiement le flambeau
Régis Debray anti-américain ? Il s’en défend, mais assume le qualificatif d’anti-impérialiste. La frontière entre les deux est bien ténue… Mais Debray nous appelle à sécher nos larmes d’un instant pour voir l’après.
« La France a joué son rôle de grande puissance entre 1640 et 1940 », écrit-il. « Cela ne veut pas dire quitter la place, mais changer de fonction. Et souvent pour un mieux. » Car la fin n’en est pas une : « Parvenue au meilleur de sa fermentation, une civilisation peut alors en inséminer d’autres » (p. 219). Comme le latin a donné le créole, l’italien, le français, l’espagnol, le roumain, le portugais.
Une civilisation doit donc savoir passer gaiement le flambeau en sachant qui elle est. Debray cite alors Paul Valéry pour résumer notre civilisation :
« Partout où les noms de César, de Gaius et de saint Paul, partout où les noms d’Aristote, de Platon et d’Euclide ont eu une signification et une autorité simultanées, là est l’Europe. »
Encore faut-il qu’elle ait clairement conscience des lents et sûrs changements qui nous arrivent. 
Raphaël Georgy
Fondateur de la revue Pierre
« Civilisation. Comment nous sommes devenus américains », Régis Debray, Gallimard, 2017



